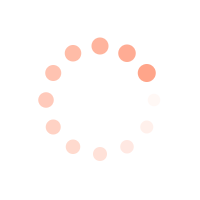Santé environnementale
La santé environnementale comprend les aspects de la santé humaine, y compris la qualité de la vie, déterminés par les facteurs physiques, chimiques, biologiques, sociaux, psychosociaux et esthétiques de notre environnement. Elle concerne également les actions de préventions mises en place.

Antennes-relais
L'Agence Nationale des Fréquences tient à jour la cartographie des émetteurs, directement accessible au public.
Le maire intervient dans un projet d’installation d’antenne relais au moment de donner, ou non, l’autorisation d’implantation à l’opérateur qui le demande, au regard du respect des dispositions du code de l’urbanisme. Le maire n'est pas appelé à se prononcer en matière d’exposition des personnes aux champs électromagnétiques, qui est du ressort de l’Agence nationale des fréquences (ANFR).
En matière d'urbanisme, le maire veille au respect :
- des règles générales d'urbanisme et de celles du plan local d'urbanisme,
- des règles de protection renforcées dans les secteurs protégés (secteur sauvegardé, site classé, réserve naturelle…),
En matière d'exposition du public aux ondes électromagnétiques, le maire peut :
- valider les demandes de mesure d'exposition dans le cadre du dispositif national de surveillance de l'ANFR,
- faire réaliser des mesures sur son territoire,
- demander la réunion d'une instance de concertation départementale (ICD) lorsqu'il estime qu'une médiation est requise.
Le Président de Toulouse Métropole est compétent pour l'installation des antennes relais sur le patrimoine métropolitain (châteaux d'eau, bâtiments ou terrains métropolitains). Dans ce cadre-là, l'avis du Maire de la commune concernée (ou du Maire de quartier pour la commune de Toulouse) est sollicité.
L'installation des antennes-relais est également encadrée par une charte qui englobe les acteurs de la Métropole et les opérateurs. Basée sur le volontariat, elle rassemble les bonnes pratiques à adopter pour l'installation des antennes.
La loi n°2015-136 du 9 février 2015, dite loi Abeille, relative à la sobriété, à la transparence, à l'information et à la concertation en matière d'exposition aux ondes électromagnétiques, vise à modérer l'exposition du public aux ondes électromagnétiques. En complément, elle vient renforcer l'information locale quant à l'exposition aux CEM et aux procédures d'information du public.
Les points principaux :
1. L'opérateur de téléphonie doit :
- transmettre un dossier établissant l'état des lieux des installations existantes à la demande du maire ou du président de l'établissement public de coopération Intercommunale (EPCI)
- informer le maire ou le président d'EPCI, par écrit, des nouvelles installations ou des modifications substantielles
2. Le maire ou le président d'EPCI :
- met à disposition des habitants le dossier d'information
- peut demander la simulation de l'exposition aux champs électromagnétiques générée par l'installation concernée par le dossier
- pourrait envisager de recueillir les observations des habitants sur le dossier d'information transmis
3. Une instance de concertation départementale peut être réunie par le préfet, pour une médiation concernant une installation radioélectrique existante ou projetée, à la demande du maire ou du président de l'EPCI.
4. La loi interdit le wifi dans les espaces dédiés à l'accueil, au repos et aux activités des enfants de moins de trois ans dans les crèches et les haltes garderies. Dans les écoles primaires où la commune a installé du wifi, il devra être coupé lorsqu'il ne sera pas utilisé pour les activités pédagogiques.
Décrets et arrêté d'application de la loi Abeille
relatif à la composition et aux modalités de fonctionnement de l'instance de concertation départementale.
relatif à l'information locale en matière d'exposition du public aux champs électromagnétiques et au comité national de dialogue de l'Agence nationale des fréquences
pris en application des A et B du II de l'article L. 34-9-1 du code des postes et des communications électroniques et relatif au contenu et aux modalités de transmission des dossiers d'information et des dossiers établissant l'état des lieux des installations radioélectriques soumises à avis ou à accord de l'Agence nationale des fréquences.
Toute personne qui le souhaite peut demander gratuitement une mesure de l'exposition aux ondes électromagnétiques à son domicile, à son travail ou à l’école de ses enfants. Il convient pour cela de solliciter la Direction de l'Environnement et Énergie.
Par mail à antennerelais@toulouse-metropole.fr
par voie postale à Toulouse Métropole - Direction de l'Environnement
6, rue René Leduc - 31500 Toulouse
Les résultats des mesures sont publiés par l'Agence nationale des fréquences (ANFR) et figurent sur le site Cartoradio, de même que l'implantation de toutes les antennes déclarées.
Environnement sonore
Actualités
Une consultation publique s’est déroulée du 16 septembre au 16 novembre 2024 pour mettre à jour le Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE) de la Métropole, programme quinquennal de lutte contre le bruit des routes de gestion métropolitaine.
Le nouveau plan d’actions a été présenté au Conseil de Toulouse Métropole du 12 décembre 2024. Il comporte des actions de :
- planification de la réduction du bruit, en intégrant l’objectif de réduction du bruit dans le PLUi-H et le plan de déplacement urbain (PDU)
- aménagement de l’espace public (insonorisation d’écoles, Ville à 30km/h, incitation à la mobilité électrique, enrobés phoniques lors de la rénovation de chaussée…)
- développement des transports en commun et des mobilités douces
- identification et sanctuarisation des zones de calme
- information et sensibilisation du public (installation de radars pédagogiques, création d’un observatoire de l’environnement sonore destiné à mesurer en continu le niveau sonore par des capteurs sur l’espace public...)
Conformément à l’application de la directive Européenne n° 2002-49, relative à l’évaluation et la gestion du bruit dans l’environnement, la Métropole doit mettre en place sur son territoire un plan d’actions de lutte contre le bruit des infrastructures routières dont elle est gestionnaire, afin de réduire la population exposée aux nuisances.
Ce plan d’action, appelé Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement (PPBE), a été adopté par la Métropole, le 12 décembre 2024, suite à une consultation publique. Une synthèse des observations de la consultation publique, est annexée au PPBE. Il est révisé tous les 5 ans.
État des lieux – Cartes de bruit Stratégiques (CBS)
Cet état des lieux est présenté sous la forme de cartes du bruit des voies routières réalisées par modélisation du bruit, prenant en compte notamment le trafic routier, la vitesse, le pourcentage de poids lourds et le type de revêtement routier.
En qualité de gestionnaire de territoire, la Métropole doit également faire apparaître dans l’état des lieux, les industries bruyantes et les grandes infrastructures de transports présentes sur le territoire :
- les industries classées ICPE, gérées par le Services de la DREAL (Direction Régionale de L’Environnement, de l’Aménagement et du Logement),
- les autoroutes concédées, gérées par ASF-VINCI
- les autoroutes non concédées, gérées par les Service de la DIRSO (Direction Interdépartementale des routes du Sud-Ouest)
- les voies ferrées gérées par la Société SNCF-Réseau
- l’aéroport de Toulouse-Blagnac, géré par la Société ATB
les cartes du bruit
Objectif : indiquer le niveau de bruit (moyen, journalier, annuel) par type de source (aérien, ferré, routier, ICPE) sur tout le territoire de la Métropole. Elles informent également sur le nombre potentiel d'habitants exposés à des niveaux de bruit supérieurs aux seuils réglementaires.
NB : Population exposée au bruit de l’aéroport Toulouse-Blagnac
Conformément à la Directive Européenne 2002/49/CE, Toulouse Métropole doit présenter dans son PPBE, une estimation de la population métropolitaine exposée au bruit aérien. La Métropole a souhaité indiquer, à titre informatif, la population exposée au bruit aérien pour chaque commune de la Métropole.
Remarque : le nombre global d’habitants exposés au bruit aérien recalculé par la Métropole, présente une différence avec celui affiché dans le PPBE d’ATB. En effet le gestionnaire de l’aéroport dispose de données de base plus fines pour calculer le nombre d’habitants impactés. Réglementairement, concernant la population exposée au bruit aérien, ce sont bien les données fournies par le gestionnaire de l’aéroport qui font foi.
Consulter les cartes du bruit sur le plan dynamique interactif :
- cartes du bruit routier des routes de gestion Métropole
- cartes du bruit routier des routes des autres gestionnaires (ASF, DIRSO)
- cartes du bruit ferroviaire
- cartes du bruit industrie
- cartes du bruit de l’aéroport Toulouse-Blagnac
Elles font apparaitre des espaces préservés du bruit des transports :
- des grandes zones naturelles : les bords de Garonne aval, la forêt de Bouconne, les espaces agricoles périphériques et les espaces agricoles aux coteaux Est
- des espaces urbains plus réduits : cœurs d'îlots bâtis en centre-ville
Et ont permis de prioriser :
- le traitement des zones subissant des dépassements de seuils
- la préservation des zones calmes
Le programme d’actions – PPBE
Ce document est un programme d'actions qui comporte toutes les mesures que la Métropole s'engage à mettre en œuvre et qui sont destinées à préserver les zones de qualité sonore et à réduire le bruit dans les secteurs bruyants.
Il est élaboré à partir du constat de la cartographie de l'environnement sonore.
Ce plan d'action vise à traiter les zones à enjeux identifiées par ordre de priorité et en fonction des enjeux et des moyens disponibles.
Les actions programmées peuvent être de plusieurs ordres :
- actions curatives. Exemple : pose d'un revêtement routier phonique, etc.
- actions préventives. Exemple : choix du scénario le moins impactant phoniquement lors de l'étude de faisabilité d'un projet
- actions de communication, d'information. Exemple : informations sur le bruit, sur le site internet de Toulouse Métropole
Un plan de prévention élaboré selon 5 axes stratégiques :
1 - Planifier la réduction de l’exposition au bruit :
- prise en compte de la qualité de l’environnement sonore dans l’élaboration du PLUi-H, et limitation du droit à construire dans les zones bruyantes
- élaboration du Plan de Déplacements Urbains, en faveur des transports en commun et des modes de transports « doux»
2 - Aménager l’espace public et insonoriser les bâtiments communaux :
- abaissement de la vitesse limite autorisée (Ville à 30km/h)
- réfection des chaussées
- isolation phonique des établissements petite enfance et groupes scolaires situés en secteurs bruyants
- actions de prévention avec la mise en place de radars pédagogiques du bruit routier
- expérimentation d’un radar-sanction de contrôle automatique du bruit routier
3 - Développer les transports en commun et favoriser les mobilités douces et alternatives :
- création de la 3e ligne de Métro
- promotion de véhicules électriques (primes à l’achat)
- intervention auprès des gestionnaires d’infrastructures de transports (Aéroport, SNCF), pour une meilleure prise en compte de l’impact sonore dans leurs activités
4 - Préserver et développer des zones de calme :
- aménagement des espaces publics de qualité
- développement de la nature en ville
- sanctuarisation des espaces publics de calme
5 - Informer et sensibiliser à la lutte contre le bruit :
- constitution d’un observatoire de l’environnement sonore, avec un réseau de mesure de l’ambiance sonore
Règlementation
Les plateformes aéroportuaires de Blagnac, Lasbordes et Francazal font l'objet de plans d'exposition au bruit destinés à permettre un développement maîtrisé des communes sans exposer au bruit de nouvelles populations.
Ces plans fixent pour les 10 à 15 ans à venir les conditions d'utilisation des secteurs exposés aux nuisances sonores des avions. Chaque zone correspond à des prescriptions, restrictions ou interdictions spécifiques.
Le plan d'exposition au bruit (PEB)
Le plan d'exposition au bruit (PEB) vise à maîtriser l'urbanisation aux abords des aéroports en se basant sur des prévisions à court, moyen et long terme. Il est composé de 4 zones : A, B, C et D.
Dans les zones A, B et C, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.
Dans la zone D, les constructions admises au Plan Local d'Urbanisme (PLU) sont autorisées sous réserve de l'application de mesures d'isolation acoustique.
Le PEB été adopté par le Conseil de la Métropole le 13 avril 2017
Dans les zones A, B et C des plateformes de Toulouse-Blagnac, Francazal et Lasbordes, l'extension de l'urbanisation et la création ou l'extension d'équipements publics sont interdites lorsqu'elles conduisent à exposer immédiatement ou à terme de nouvelles populations aux nuisances de bruit.
Dans la zone D des aérodromes de Toulouse-Blagnac et Lasbordes, les constructions admises au plan local d'urbanisme (PLU) sont autorisées sous réserce de l'application de mesures d'isolation accoustique.
Qu'est-ce que l'indicateur Lden ?
Lden : "level, day, evening", night" ou niveau jour, soirée, nuit.
Indicateur du niveau sonore moyen sur 24h (jour, soir et nuit) utilisé pour qualifier la gêne liée à l'exposition au bruit. Il est calculé à partir des moyennes de niveaux sonores sur les périodes 6h-18h (jour), 18h-22h (soirée) et 22h-6h (nuit). De plus, une pondération de +5 dB(A) est appliquée à la période du soir et de +10 dB(A) à celle de la nuit, pour tenir compte du fait que nous sommes plus sensibles au bruit au cours de ces périodes.
Aide à l'insonorisation des logements des riverains de l'aéroport
Afin de protéger les riverains de l'aéroport de Toulouse-Blagnac du bruit des avions, une aide financière pour l'insonorisation des logements est accordée sous certaines conditions.
Cette aide est financée par la taxe sur les nuisances sonores aériennes (TNSA), taxe perçue auprès des compagnies aériennes. L'aide à l'insonorisation concerne les logements et les établissements sensibles (sanitaires, sociaux et d'enseignements).
Ce fond d'aide est géré par le service environnement de la société Aéroport Toulouse Blagnac.
Qu'est-ce que le Plan de Gêne Sonore (PGS) ?
Approuvé par arrêté préfectoral du 31/12/2003 et complémentaire du plan d'exposition au Bruit (PEB), le plan de gêne sonore (PGS) définit 3 zones géographiques, les zones 1, 2, et 3, dans lesquelles des aides financières peuvent être accordées sous certaines conditions (notamment la construction de logements avant l'application du PEB), pour insonoriser les habitations existantes.
Cet outil est établi à partir de prévisions de trafic à court terme, et est financé par les compagnies aériennes ("taxe sur les nuisances sonores aériennes" due à chaque décollage).
Il se présente sous forme d'un rapport et d'une carte à du l'échelle
1/25 000e indiquant 3 types de zones :
- la zone 1 dite de très forte nuisance comprise à l'intérieur de la courbe d'indice Lden 70
- la zone 2 dite de forte nuisance, entre la courbe d'indice Lden 70 et Lden 65 ou 62
- la zone 3 dite de nuisance modérée inclut entre la limite extérieure de la zone 2 et Lden 55
Conditions d'attribution de l'aide à l'insonorisation
- avoir son logement situé dans le plan de gêne sonore (PGS) en vigueur
- avoir son logement situé hors de la zone du plan d'exposition au bruit (PEB) lors de sa construction
- ne pas avoir déjà bénéficié de cette aide
Déposer une demande d'aide à l'insonorisation
Actions menées par l’aéroport, pour réduire l’impact sonore de son activité
L’Aéroport Toulouse Blagnac poursuit ses actions pour maîtriser les nuisances sonores. Quelques chiffres clés.
- Fin 2024, plus de 12 700 foyers ont bénéficié d’une insonorisation et 8 établissements scolaires pour un montant global de 80 millions d’euros.
- 75 933 mouvements d’avions en 2024 / 100 635 en 2019.
- En 2024, 954 vols* ont atterri ou décollé à l’aéroport de Toulouse Blagnac en cœur de nuit (entre minuit et 6 heures du matin) / 1 236 vols en 2023.
* Nota bene : un mouvement = un atterrissage ou un décollage
Plan de Prévention du Bruit dans l’Environnement de l’Aéroport (PPBE)
Les actions pour maîtriser et réduire les nuisances sonores sont recensées dans un Plan de Prévention du Bruit pour l’Environnement (PPBE) spécifique qui agit sur différents leviers. Il s’articule autour de quatre « piliers » correspondant à des mesures graduées qui doivent être examinées dans l’ordre suivant :
- la réduction à la source du bruit des avions
- les procédures opérationnelles d’exploitation à moindre bruit
- la planification et la gestion de l’utilisation des sols
- en dernier recours, les restrictions d’exploitation
Les mesures de restrictions d’exploitation envisagées ont fait l’objet d’une étude d’impact selon l’approche équilibrée (EIAE) * menées sous l’égide de la préfecture en 2024.
Le PPBE 2018-2024 a recensé une trentaine d’actions portées par les parties prenantes dont la majorité a été réalisée.
Un nouveau PPBE est en cours d’élaboration pour la période 2025-2029.
En savoir plus sur le PPBE
En savoir plus sur la gestion du bruit de l’aéroport
* EIAE – Etude d’Impact d’Approche Équilibrée
Lancée en septembre 2023, cette enquête, menée par l'État avec le soutien de la Direction générale de l’Aviation civile, vise à évaluer les possibles mesures de réduction du trafic aérien en période nocturne, dans le but de limiter les nuisances pour les riverains.
À la suite des conclusions de l’EIAE, le Préfet a retenu la proposition d’un projet d’arrêté de restriction des vols de nuit sur la base du « scenario 2 sécurisé ». Le gestionnaire de l’aéroport a donc interdiction de programmer des vols commerciaux en cœur de nuit (00h-6h), avec un plafonnement des vols arrivants en retard sur ce créneau horaire.
Le transport routier et ferroviaire génère des nuisances sonores de plus en plus mal ressenties de la part des populations riveraines.
Routes
- Anticipation du bruit des infrastructures nouvelles ou modifiées
Des obligations précises en matière de protection contre le bruit s'imposent à tous les maîtres d'ouvrage d'infrastructures de transports terrestres lors de créations ou de modifications significatives de routes et notamment la réalisation d'une étude d'impact sonore et la définition des objectifs de protection à réaliser.
- Application du classement des voies bruyantes
Les voies de plus de 5 000 véhicules/jour sont classées en 5 catégories sonores, la classe 1 étant la catégorie la plus bruyante, et la classe 5 la moins bruyante. À chaque catégorie correspond une zone de nuisances sonores potentielles appelée "secteur affecté par le bruit".
Arrêté préfectoral du classement sonore de la Haute-Garonne du 21 janvier 2025
Ce dispositif réglementaire préventif permet de fixer les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments sensibles devront respecter, et de disposer d'une base d'informations pour des actions complémentaires à la réglementation acoustique des constructions.
Voies ferrées
Lors de créations ou de modifications significatives de voies ferrées, la réalisation d'une étude d'impact sonore et la définition des objectifs de protection des riverains est menée par la société SNCF-Réseau avec la participation, pour avis, de Toulouse Métropole.
Les voies de plus de 50 trains/jour sont classées en 5 catégories sonores, la classe 1 étant la catégorie la plus bruyante, et la classe 5 la moins bruyante. À chaque catégorie correspond une zone de nuisances sonores potentielles appelée "secteur affecté par le bruit".
Ce dispositif réglementaire préventif permet de fixer les performances acoustiques minimales que les futurs bâtiments sensibles devront respecter, et de disposer d'une base d'informations pour des actions complémentaires à la réglementation acoustique des constructions.
Arrêté préfectoral du classement sonore de la Haute-Garonne du 21 janvier 2025
Les industries bruyantes sont répertoriées dans la liste des Installations classées pour la protection de l'environnement (ICPE) soumises à un contrôle périodique de leur impact sonore sur l'environnement.
Avant toute ouverture d'une activité industrielle classée pour la protection de l'environnement, une demande d'autorisation d'exploiter est déposée en préfecture.
Suite à une étude d'impact sur l'environnement, l'avis du maire de la commune concernée est demandé.
L'action de Toulouse Métropole est de maîtriser l'urbanisme à proximité de ces sites industriels.
Ilots de chaleur urbains
Un îlot de chaleur urbain (ICU) ce sont des élévations localisées des températures, particulièrement des températures maximales diurnes et nocturnes, enregistrées en milieu urbain par rapport aux zones rurales ou forestières voisines.
Pour offrir à ses habitants une métropole respirable et résiliente face au changement climatique, Toulouse Métropole déploie plusieurs dispositifs innovants de suivi et de lutte contre les îlots de chaleur urbain (ICU) sur son territoire. Ces actions s’inscrivent dans le volet Adaptation de son Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET).
Un enjeu de santé publique
Périodes de canicules plus fortes et plus fréquentes, aggravation des épisodes de pollution…Les effets du réchauffement climatique se font déjà ressentir sur la métropole toulousaine. Dans ce contexte, un aménagement urbain non adapté peut venir encore accentuer ces effets et aggraver notamment le phénomène d’îlots de chaleur urbain (ICU) : configuration des rues, volumes et agencement des bâtiments, couleurs, revêtements et matériaux (bitume, béton, acier, briques) peuvent agir comme de véritables radiateurs urbains.
L'augmentation des températures et de la fréquence des épisodes de fortes chaleurs ont pour conséquence de diminuer le « confort d'été » de la population et peuvent constituer un véritable « risque sanitaire » pour les populations les plus sensibles aux fortes chaleurs, en particulier les personnes âgées.
Objectif : une ville de demain respirable
Anticiper et s'adapter à l'impact du changement climatique est une priorité de Toulouse Métropole, pour une ville de demain respirable.
Voilà pourquoi la dynamique d'adaptation au changement climatique est inscrite au cœur du Plan local d'urbanisme intercommunal - Habitat (PLUi–H). Il a pour objectif de définir un projet urbain pour Toulouse Métropole et d'établir de façon équilibrée les règles de développement de l'urbanisme et de l'habitat pour les 37 communes membres.
Le Projet d'Aménagement et de Développement Durable (PADD) inscrit la croissance urbaine de la métropole dans une logique de développement durable en infléchissant les modèles de développement pour faire face à la raréfaction des ressources et prend en compte l'environnement pour ce qu'il apporte au bien commun :
- conforter les continuités vertes et bleues ;
- réduire l'impact du changement climatique et s'adapter à ses effets (en diminuant notamment les effets des Îlots de Chaleur Urbains (ICU) dans les zones urbanisées, en renforçant la place de la nature en ville, grâce à des formes urbaines et des choix d'urbanisme adaptés, et en valorisant les canaux et les berges).
Des capteurs météo connectés pour observer le climat urbain
L'îlot de chaleur urbain (ICU) est suivi de près dans la Métropole : la collectivité a déployé sur son territoire plus de 70 capteurs météo connectés en collaboration avec le Centre National de Recherche en Météorologie (CNRM). Les données de températures, vent, humidité ou précipitation sont mises à la disposition du public sur le portail Open data de la Métropole.
Construire la ville de demain
En parallèle, la métropole toulousaine a souhaité s'appuyer sur des outils spécifiques permettant d'intégrer de façon très opérationnelle les enjeux climatiques dans la construction de la ville de demain et multiplier ainsi les projets d'aménagements durables.
- Score ICU, pour limiter l’aggravation des îlots de chaleur
Il classe les aménagements selon 9 tranches de chaleur, de la plus fraîche à la plus chaude et définit un score, sans unité, indiquant si l’aménagement a, ou va améliorer ou dégrader le confort thermique estival lié aux îlots de chaleur urbains. Ce classement se fait selon plusieurs facteurs comme le type de matériaux exploités et leur couleur, le positionnement (à l’ombre ou au soleil) ou encore la présence de végétation et d’eau, par exemple.
Il peut ainsi permettre de simuler différents scenarios possibles du projet (état actuel et états projetés) mais également de comparer les résultats de leurs impacts respectifs avec ceux d’autres places emblématiques de Toulouse comme la place Saint Georges et la place du Capitole.
- Score perméabilité, pour limiter l’imperméabilisation des sols
Selon leurs surfaces et leurs perméabilités, il classe les matériaux mis en œuvre sur les sols et toitures du projet et calcule un score global pour le projet allant de 0 pour une parcelle entièrement perméable à 1 pour une parcelle entièrement imperméable.
Quatre grands projets d’aménagement accompagnés sur la métropole
Avec l’appui de ces outils, Toulouse Métropole souhaite mettre en place les bons réflexes en commençant par quatre grands projets d’aménagement : le futur quartier Guillaumet, la rénovation du parking relais du métro de Jolimont, l’aménagement de la future place centrale du projet Faubourg Malepère et celui du cœur de village de la commune de Mons.
Voir le guide de recommandations pour construire la métropole de demain
Contrôle de l'hygiène alimentaire
Les contrôles d'hygiène dans le domaine alimentaire sont à la fois systématiques et/ou réalisés à la suite de plaintes.
Les contrôles systématiques
A Toulouse, tous les lieux où sont commercialisés des denrées alimentaires transformées ou pas, avec consommation sur place ou pas, peuvent êtres contrôlés par les inspecteurs du Service Communal d'Hygiène et de Santé (S.C.H.S) ainsi que par le personnel de la direction des services vétérinaires et de la direction départementale de la concurrence de la consommation et de la répression des fraudes (DDCCRF).
Les contrôles portent sur l'aménagement des locaux, le tenue du matériel et de l'établissement, le respect des règles d'hygiène alimentaire dans la conservation des denrées par le personnel de l'établissement.
En cas d'infraction constatée, une mise en demeure est prononcée, un procès verbal est dressé. S'ils restent sans effet, une amende de troisième classe est donnée, et enfin la fermeture de l'établissement est imposée.
Les contrôles à la suite d'une plainte
Les plaintes proviennent aussi bien des clients mécontents que des voisins gênés par les activités de l'établissement, la plupart du temps il s'agit de problèmes d'odeurs provenant des cuisines ou de nuisances sonores que ces lieux provoquent sur la voie publique.
Les plaintes sont traitées comme des plaintes de voisinage. L'établissement alimentaire est aussi contrôlé.
Pour plus d'information
Service Communal d'Hygiène et de Santé
Service d'hygiène alimentaire par canton
17, place de la Daurade
31040 Toulouse cedex 8
tél. : 05 61 22 23 30
Lutte contre l'amiante
L'amiante et ses dérivés industriels représentent un danger réel pour la santé : les particules d'amiante, peuvent créer des troubles graves dans l'organisme entraînant la mort des personnes contaminées. La maladie peut se déclarer plusieurs dizaines d'années après l'exposition.
Ces micro-particules peuvent être présentes dans l'eau ou dans l'air, de manière naturelle (zones de montagnes exposées à l'érosion) ou artificielle (abords de bâtiments amiantés mal isolés, travaux de désamiantage mal effectués).
- dans l'eau, elles représentent un danger relatif
- dans l'air, elles représentent un danger mortel pour l'organisme.
L'amiante n'est donc pas directement dangereux (dans des bijoux, il est, par exemple, mélangé à du quartz). C'est le taux d'empoussiérage de l'air créé par l'effritement ou la transformation des produits dérivés qui est dangereux.
Ses effets sur la santé ont conduit à un contrôle, à une limitation progressive de son usage et à des dispositions de protection des personnes exposées. Au 1er janvier 1997, l'usage de l'amiante a été interdit en France.
Lutte contre la légionellose
Les causes de la maladie
La Legionella pneumophila, responsable de 90 % des cas de légionellose, prolifère dans les eaux stagnantes. Sa température optimale de développement se situe entre 25 et 43°C et elle colonise facilement les installations collectives de production et de distribution d'eau chaude (les douches, les bains à remous), les tours aéro-réfrigérantes, les dispositifs de traitement d'air, les jets d'eau, les fontaines décoratives.
L'exposition résulte de l'inhalation de fines gouttelettes d'eau contaminée (aérosols) qui peuvent être produites par de très nombreuses installations. Sont plus particulièrement exposées au risque de légionellose les personnes fragiles (personnes âgées et/ou présentant un état de santé fragilisé - immunodéprimés, insuffisants respiratoires graves.).
La légionellose est une maladie à déclaration obligatoire (depuis 1987).
Symptômes
Elle atteint les poumons, les reins et le système nerveux. L'incubation est de 2 à 10 jours.
Les symptômes ressemblent à ceux de la grippe pendant 3 ou 4 jours (diarrhée, vomissements, céphalées, douleurs abdominales, douleurs musculaires, toux sèche, petite fièvre et somnolence). En quelques jours, la fièvre s'élève et les douleurs musculaires s'aggravent. La pneumonie se traduit par une douleur dans la poitrine, des difficultés pour respirer et une toux sèche. Le rétablissement est total, en général, en 3 semaines sous traitement antibiotique. En cas de doute contactez votre médecin
Pour en savoir plus
Intoxication au monoxyde de carbone
Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel. Une mauvaise combustion et une mauvaise aération du logement peuvent être les causes de ce danger.
Il existe des gestes simples pour éviter les intoxications.
Pourquoi le monoxyde de carbone est dangereux ?
Le monoxyde de carbone est un gaz invisible, inodore, toxique et mortel.
Il est le résultat d'une mauvaise combustion quelle que soit la source d'énergie : bois, gaz (naturel, butane, propane...) charbon, essence
Il s'agit comme un gaz asphyxiant très toxique prenant la place de l'oxygène dans le sang. Il peut s'avérer mortel en moins d'une heure.
Quelles sont les causes du danger ?
Une mauvaise combustion et une mauvaise aération du logement :
- appareils de chauffage et de production d'eau chaude ainsi que les inserts, poêles, cuisinières, chauffages d'appoint mal entretenus,
- mauvaise aération du logement ventilation dans la pièce où est installé l'appareil,
- fumées mal évacuées
Comment éviter les intoxications ?
- faites vérifier chaque année vos installations par un professionnel : chaudières, chauffe-eau, cheminée, inserts et poêles
- aérez votre logement même en hiver et ne bouchez jamais les entrées d'air
- faites effectuer un ramonage mécanique de vos conduits et cheminées au moins une fois par an
Que faire si vous soupçonnez une intoxication ?
Si vous avez des maux de tête, des nausées, des vomissements ... pensez au monoxyde de carbone. En cas de suspicion :
- aérez immédiatement les locaux en ouvrant portes et fenêtres
- arrêtez vos appareils à combustion si possible
- évacuez les locaux et bâtiments
- appelez les secours : numéro unique d'urgence européen : 112 // Pompiers : 18 // Samu : 15
- ne ré-intégrez pas les lieux avant d'avoir reçu l'avis d'un professionnel.
Contact
Service Communal d'Hygiène et de Santé
17 place de la Daurade
31040 Toulouse Cedex 7
Tél. 05 61 22 23 32 / 27 42
Ressources utiles
Nuisances sonores et olfactives
Concernant les bruits de voisinage les horaires sont les suivants :
- jours ouvrables : 8h30 à 12h et 14h à 19h30
- samedi : 9h à 12h et 15h à 19h
- dimanche et jours fériés : 10h à 12h et 16h à 18h
Les composés odorants émis par un site, les nuisances sonores peuvent provoquer une gêne pour les riverains. La mairie met à disposition des Toulousains différents moyens de lutte afin d'améliorer le cadre de vie, par le biais du service communal d'hygiène et de santé.
Nuisances sonores
Le bruit de voisinage peut être émis par deux types de sources :
- sources privées liées aux comportements des personnes
- sources commerciales ou industrielles liées aux lieux musicaux, infrastructures urbaines, exploitations d'industries…
Le bruit est le deuxième facteur de nuisances en regard de l'hygiène, de l'habitat et du cadre de vie. Ces dernières années, des études et de nouvelles réglementations ont été mises en place et on peut déjà mesurer les conséquences de leur application.
Ces effets traduisent les efforts de la municipalité qui dispose, avec le Service Communal d'Hygiène et de Santé, d'un ensemble de moyens humains et techniques aussi bien d'évaluation et de mesures que d'intervention.
Dans tous les bars musicaux, et suite à des plaintes de riverains, des études acoustiques ont été faites et ont été complétées par des relevés sono métriques.
Sensibilisation de la population aux nuisances sonores, contrôle et mise en application de la réglementation, meilleure visibilité et traçabilité de l'action du S.C.H.S. dans le cadre de sa mission d'hygiène urbaine ont amené la diminution sensible du nombre de plaintes pour motifs de bruit, alors que dans un même temps, le nombre de plaintes reçues par notre service, tous motifs confondus, augmentait.
Les nuisances olfactives
Les composés odorants émis par un site peuvent provoquer une gêne pour les riverains. Cela dépend des seuils olfactifs des composés, de leur concentration, de la nature du mélange, de la direction et la vitesse du vent, mais aussi de la sensibilité des personnes.
En effet, les messages olfactifs que nous recevons de notre environnement ont un impact affectif plus ou moins fort selon chacun. Le problème des nuisances olfactives prend alors une dimension subjective.
Après le bruit, la pollution odorante est le deuxième motif de plainte. Elle peut être expliquée par l'importance donnée aux odeurs par le riverain. L'odeur est en effet associée à la notion de toxicité. Une association sans fondement dans la plupart des cas puisque les composés odorants peuvent être perçus par l'être humain à des niveaux de concentration très faibles.
Syndrome de Diogène
Qu'est ce que le syndrome de Diogène
Le syndrome de Diogène est un dérèglement du comportement chez la personne qui se traduit par deux troubles associés : l'incurie et la syllogomanie.
L'incurie est une absence totale d'hygiène personnelle et la syllogomanie est un T.O.C. (trouble obsessionnel compulsif) qui conduit à amasser ou à ne pas jeter un grand nombre d'objets inutiles voire de déchets, même si leur accumulation cause des inconforts majeurs.
Il existe deux types de syndrome de Diogène : l'actif et le passif. L'actif consiste à entasser chez soi toutes sortes de choses récupérées dans la rue ; quant au passif, il revient à se laisser envahir par ses déchets voire même ses déjections et à se laisser déborder par leur accumulation.
Personnes concernées
Le syndrome de Diogène touche essentiellement des personnes âgées de plus de 60 ans de tout milieu social ; généralement après une rupture sociale comme le décès d'un proche ou le départ à la retraite.
Ces individus sombrent peu à peu dans une dépression et ils se mettent à combler le vide autour d'eux par l'accumulation d'objets ou de déchets.
Intervention du Service Communal d'Hygiène et de Santé
À l'heure actuelle, une vingtaine de cas sont signalés par an auprès du SCHS, des services sociaux, de la police ou des pompiers. Lorsqu'une personne signale que des odeurs délétères émanent du logement de son voisin les inspecteurs de salubrité du Service Communal d'Hygiène et de Santé se rendent sur place, autant de fois que nécessaire, jusqu'à ce qu'ils rencontrent l'habitant. S'ils n'y parviennent pas, ils font une demande de référé auprès des affaires juridique pour pouvoir procéder à un état des lieux du logement.
Après une estimation de la capacité de l'occupant à nettoyer son logement, ce qui est rarement le cas, ils font intervenir une entreprise de nettoyage.
Protocole pour une prise en charge
Depuis plusieurs années, le SCHS de la mairie de Toulouse a établi un protocole avec le Conseil Départemental, le Centre Hospitalier Gérard Marchant et le Centre Hospitalier Universitaire afin de mettre en œuvre une prise en charge coordonnée des personnes atteintes du syndrome de Diogène.
Les services sociaux et les associations ont désormais pour mission d'accompagner les personnes, souvent non demandeuses d'aide au départ, non seulement pour éviter que l'amoncellement de détritus se renouvelle, mais aussi pour recréer du lien social autour d'elle.
En outre, lorsque c'est nécessaire, les services psychiatriques initient une démarche de soins avec la personne.
Qualité de l'eau
Les contrôles réglementaires de la qualité de l'eau potable, des eaux de piscines et de baignade sont réalisés par les agents de l’État.
A Toulouse, ce sont les agents du SCHS qui représentent le ministère de la Santé et qui effectuent ces contrôles. Les analyses sont réalisées par le laboratoire départemental de l'eau.
La législation en vigueur impose d'effectuer des analyses fréquentes pour vérifier la qualité de l'eau potable. A Toulouse, ces résultats sont affichés tous les jours dans les mairies de quartier.
En ce qui concerne l'eau de baignade, les contrôles réglementaires se font au moins une fois par mois. Les résultats sont affichés à l'intérieur des piscines.
Contact
S.C.H.S
Référent eau
tél. : 05 61 22 23 31